Appel à candidature pour le Prix Santé Entrepreneurs

Entre crues soudaines, sécheresses et impact de l'activité humaine, l’état des cours d’eau en Haute-Loire est mis à rude épreuve. Si la qualité reste globalement satisfaisante, la biodiversité aquatique montre des signes d’alerte. Les recherches menées en 2024 soulignent les problématiques qui apparaissent ou persiste et qui pourraient devenir incontrôlable à l'avenir.
En 2024, le laboratoire Ingé 43, en partenariat avec le laboratoire Terana et la Fédération de pêche de la Haute-Loire, a réalisé 288 prélèvements sur 29 cours d’eau du département. L’attention a été particulièrement portée sur le secteur du Lignon, choisi cette année comme secteur renforcé parmi les trois grands bassins versants : la Loire, l’Allier et le Lignon.
Ce suivi permet d'évaluer l’état écologique des cours d’eau à travers divers indicateurs, notamment biologiques (invertébrés, poissons), chimiques et hydrologiques.
Un climat instable
L’année 2024 a été marquée par une pluviométrie extrêmement variable, rythmée par des périodes de sécheresse sévères et des crues, comme celle du 17 octobre qui a impacté sévèrement le bassin versant Loire-Lignon.
Nathalie Rousset, conseillère départementale déléguée à l'eau, constate que « les mouvements climatiques remontent du sud vers notre territoire. On est de plus en plus impactés par un climat méditerranéen, avec des épisodes violents. »
« Il y a 40 ans, on ramassait les truites à la main. Aujourd’hui, c’est devenu rare »
Les conséquences sur les écosystèmes aquatiques sont déjà visibles. Les invertébrés et les poissons, indicateurs essentiels de la santé des cours d’eau, sont particulièrement affectés.
Les variations brutales de débit, les chocs thermiques et la disparition progressive de leur habitat fragilisent leur présence. « Il y a 40 ans, on ramassait les truites à la main. Aujourd’hui, c’est devenu rare. Les poissons ne résistent plus aux crues : ils sont emportés, blessés contre les rochers... Les changements sont significatifs », explique Philippe Delabre vice-président au comité départemental exécutif.
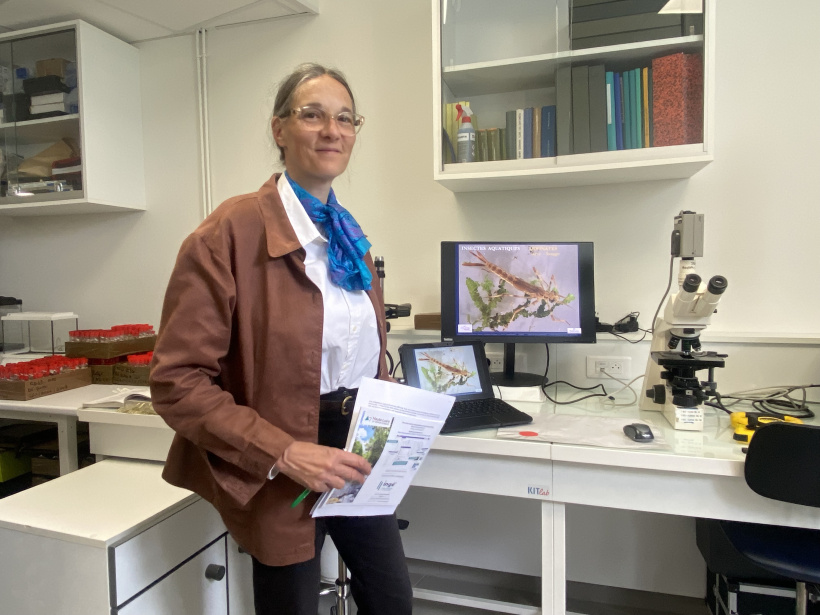
Les voyants sont au vert, mais la vigilance reste de mise
Les résultats de l’année l’état physico-chimique, éléments qui permettent à des organismes vivants de se développer sainement, restent bons avec 90% des sites étudiés en bon ou très état, perturbés par des phénomènes d'eutrophisation et de prolifération d’algues dus à l'augmentation de présence du phosphore et de nitrate.
« L'écart est colossal et quand même très préoccupant pour les années à venir »
Quant à la qualité biologique, qui tient compte dans ces calculs de la qualité des vie des diatomées, les invertébrés et poissons, les résultats sont plus oscillants et montrent une dégradation et des perturbations liées aux conditions météorologiques extrêmes, l’impact des activités humaines (agriculture, rejets urbains, piétinement du bétail).
Les années 2022 et 2023 ont marqué une nette dégradation des milieux aquatiques, seules 37 % des masses d’eau sont en bon état écologique « l'écart est colossal et quand même très préoccupant pour les années à venir. »
Résultats de l'année 2024 du réseau Départemental
« On voit les invertébrés qui réagissent alors que jusqu'à présent, c'étaient vraiment les indicateurs qui étaient quasiment les plus stationnaires. Par contre, on se rend compte quand on analyse un petit peu finement, qu'en fait, ils commencent à réagir. Les poissons, eux, ont réagi déjà depuis un moment et les diatomées ont une réaction beaucoup plus rapide » Ludovic Beyeler, référent de la cellule Rivières.
En croisant les données des différents constats, l’état reste globalement bon, avec des progrès à poursuivre sur la réduction du phosphore et la préservation des habitats biologiques.

Le sol, régulateur hydrique
Nathalie Rousset attire aussi l’attention sur l’état des sols, de plus en plus compactés et lessivés, en lien avec certaines pratiques agricoles ou forestières comme les coupes à blanc « on se retrouve de nouveau avec un sol qui n'absorbe pas, qui ne fait pas le rôle des bronches, parce qu'il est un peu matraqué et il y a plus de végétation dessus. »
En Haute-Loire, l’agriculture notamment, du côté de l’élevage, est confrontée à la question cruciale de l’abreuvement du bétail, tout en veillant à préserver les milieux humides fragilisés. « Il y a une vraie conscience dans le monde agricole, mais la vigilance reste nécessaire » ajoute Nathalie Rousset.
De plus, une attention particulière est portée à la gestion des grandes cultures notamment de l’utilisation de produits chimiques (engrais, pesticides) sur les parcelles peut entraîner un lessivage des sols, notamment lors de fortes pluies, avec un risque de pollution des cours d’eau. Une fois les molécules chimiques présentes dans le milieu naturel, il est très difficile, voire impossible, de les éliminer.
« il y a des chances qu’on soit chahutés. Météo France n'est pas très optimiste. »
Pour le moment, aucun prélèvement chimique n’est effectué pour le moment, les analyses étant limitées par le coût élevé des tests les plus poussés. « Les mesures sur les phytosanitaires sont excessivement chères, et nous n'avons pas, à ce jour, les cofinancements nécessaires », explique Nathalie Rousset.
Un avenir incertain
Les perspectives pour la suite de 2025 ne sont pas optimistes. Malgré des réserves d’eau encore pleines dans les grands barrages, leur niveau baisse plus rapidement qu’à l’accoutumée « il y a des chances qu’on soit chahutés. Météo France n'est pas très optimiste. »
« Pour la végétation, c’est catastrophique »
Et la situation ne semble pas s’améliorer, juin 2025 ayant été le deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré, selon Météo France. « Pour la végétation, c’est catastrophique » lance Nathalie Rousset « Aujourd'hui d'un point de vue national, les réserves, dont les grands barrages, sont encore un peu pleines, mais on les a attaquées très fort ces quelques derniers jours. »
Face à ces constats, l’enjeu est clairement le suivi écologique des différents sites du département afin d'adapter les pratiques d’aménagement et renforcer la prise de conscience autour de la gestion de l’eau et du climat.

Vos commentaires
Se connecter ou s'inscrire pour poster un commentaire
5 commentaires
Excellent article, à transmettre d'urgence au sénateur Duplomb .
Si les analyses biologiques sont important une autre analyse devrait être réalisé. Par exemple sur la Loire, les microcentrales électrique au fil de l'eau ne doivent pas réaliser d'éclusage, cela n'est pas le cas et en toute impunité.
Quand la Loire est à l'étiage, et que le débit passe de 4 m3/s à 2m3/s je ne pense pas que cela bénéfique pour la qualité de l'eau ni la biodiversité.
Tout le monde connaît l'adage, "une rivière est propre jusqu'au premier village". Les soubresauts du climat n'arrangent rien.
Fini le temps ou l'on voyait des truites par bancs ,se délectaient dans une eau limpide, de toutes ces p'tites bêtes ,et qui faisaient le bonheur du pêcheur(pas viandards) ....Ou sont passés nos gros "blancs" qui mouchés dans les plats de la Loire; ou sont passés les gros barbeaux(à part au Sénat) qui nettoyaient le fond des courants etc etc.....
Une nouvelle Loi autorise de faire des méga bassines, la réintroduction de néo(JA)cotinoïdes, le droit de polluer (si ce n'est pas intentionnel)....Les terroristes en col blancs, ont le pouvoir et nous, on regarde se dégrader nôtre Vie(qui est aussi la leur)
« Les mesures sur les phytosanitaires sont excessivement chères, et nous n'avons pas, à ce jour, les cofinancements nécessaires », explique Nathalie Rousset.
il faut demander à son ami sénateur, auteur de la loi Duplomb !!!